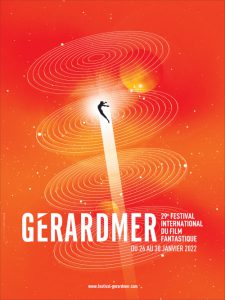Après une édition 2021 en ligne pour cause de crise sanitaire, les bataillons des habitués du Festival de Gérardmer se sont enfin retrouvés dans une ambiance joyeuse, unis dans une ferveur que deux années de pandémie auront été impuissantes à entamer. La sélection 2022 s’est avérée en outre d’une excellente tenue, alors du 26 au 30 janvier, c’était à bien Gérardmer et nulle part ailleurs qu’il fallait aller ! Retour critique sur les films de la compétition.
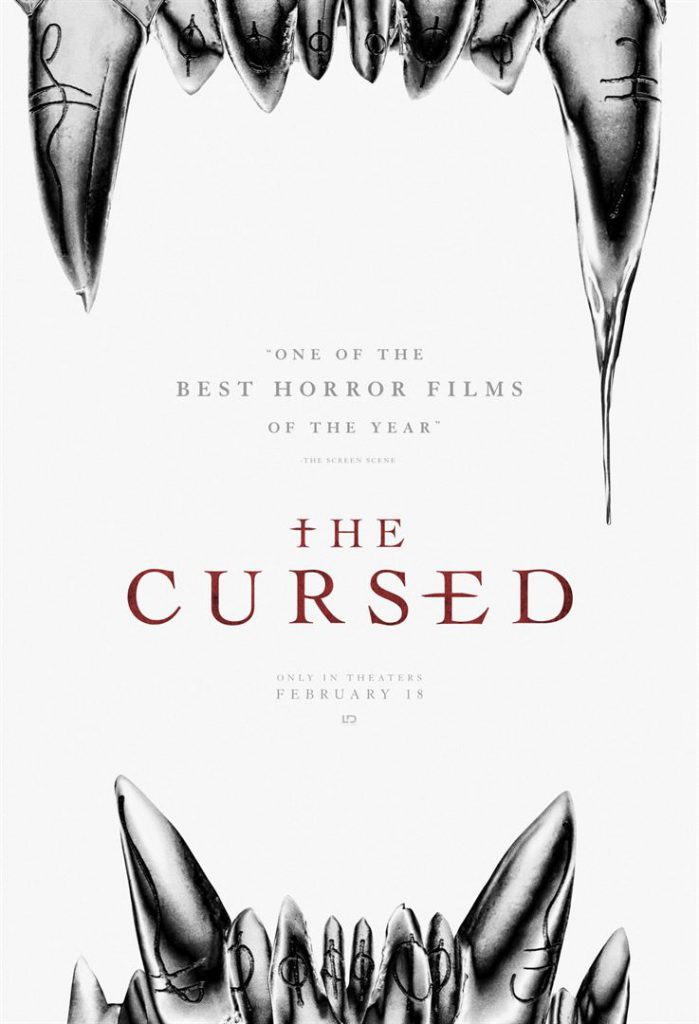
EIGHT FOR SILVER
(THE CURSED)
de Sean Ellis
(Royaume-Uni)
Après une scène d’ouverture dans les tranchées de la bataille de la Somme, le Britannique Sean Ellis règle sa caméra à remonter le temps pour nous envoyer plus loin encore, dans la France rurale du XIXème siècle. Eight For Silver a été tourné en Charente, pourtant il n’est pas évident de trouver des repères frenchies dans cette histoire jouée en anglais par des comédiens britanniques (deux ou trois acteurs français seulement se partagent des rôles secondaires — il y a Roxane Duran, vue dans Évolution). Sur les terres d’un aristocrate (qui a tout d’un nobliau de l’Angleterre victorienne, et il se prénomme Seamus) s’installe un campement de gitans, une vingtaine de bohémiens venus réclamer de soi-disant droits à s’approprier quelques arpents. Ça ne va pas se passer comme ça : avec l’appui d’autres notables (le clergé local aussi est de la partie, hé hé), ledit Seamus Laurent loue les services d’hommes de main qui ont tôt fait de massacrer les nomades…

Ce n’est pas Sam Raimi qui va nous contredire (vous avez bien vu Jusqu’en enfer ?), le personnage de la vieille gitane un peu sorcière, lanceuse de malédiction, est un archétype des récits d’horreur. C’est le cas ici, avec une vengeance d’outre-tombe convoquant des loups-garous, un autre topos du fantastique que le scénario rapproche hardiment des exactions de la fameuse Bête du Gévaudan, au temps où Louis XV portait la couronne à Versailles. Tel Ichabod Crane/Johnny Depp dans Sleepy Hollow, un scientifique du nom de John McBride enquête dans le manoir Laurent et alentour pour comprendre la nature de la menace griffue qui s’en prend à la population. Donc plein de choses déjà vues dans d’autres films, cela dit la reconstitution en costumes est de qualité, l’image est superbe (ambiance torches et brume) et les comédiens excellents (Kelly Reilly joue avec intensité la maîtresse de maison doublée d’une mère éplorée). Les lycanthropes en CGI, en revanche, jurent un peu avec le cadre historique. Une entrée en matière raisonnable dans la compétition, comme une manière pour les programmateurs d’épargner les émotions du public avant de nous faire écarquiller les mirettes sur plusieurs merveilles qui vont suivre dans les jours à venir…

POST MORTEM
de Péter Bergendy
(Hongrie)
À peine dissipées les brumes d’Eight For Silver, on retombe dans les affres historiques de la Grande Guerre : pour ainsi dire revenu d’entre les morts après avoir été soufflé par une explosion sur l’enfer du front, un soldat allemand miraculé parcourt la Hongrie rurale de 1918 avec une chambre photographique. À la demande des familles, Tomàs réalise des clichés des défunts, nombreux car, ne l’oublions pas, outre le martyre de la guerre l’Europe était en proie à l’épidémie de grippe espagnole, qui fit des millions de morts. Les us hongrois voulaient qu’à cette terrible époque les maris, épouses, enfants, parents… posassent endimanchés en compagnie de leurs chers disparus avant de les mettre en terre.

Depuis son tournage en 2018, ce deuxième titre de la compétition a fait la tournée des festivals — Trieste, Neuchâtel, Sitges ou encore le BIFFF, pour ne citer que ceux-là —, et Post Mortem s’est adjugé pas moins de quatre trophées à la remise des prix des « Oscars » hongrois. A priori, un film prompt à faire l’unanimité, cependant la projection à Gérardmer fait mesurer à quel point la réception peut varier d’un spectateur à l’autre. Ayant posé ses bagages au milieu d’une population de villageois harcelés par des spectres, Tomàs le photographe assiste à des manifestations surnaturelles dont il fait lui-même les frais et qui font s’esclaffer quelques loustics du public : quand les fantômes s’activent, les paysans du cru se retrouvent secoués, soulevés voire baladés sur le dos et sur des dizaines de mètres par des serres invisibles. Des effets parfaitement réalisés pour un résultat risible aux yeux de certains qui, une fois dehors, compareront le film à Scary Movie (quand même !). Dans d’autres dispositions, on a moins de problèmes à prendre l’histoire au sérieux. L’originalité du cadre campagnard hivernal (il gèle à fendre les os) ainsi que des séquences macabres rarement vues (les séances photo avec les macchabées, d’une loufoquerie lugubre) réussissent à tenir l’ennui à l’écart malgré les presque deux heures de projection. Outre le dénommé Viktor Klem dans le rôle du photographe, la distribution (semi-pro, certains rôles sont tenus par d’authentiques péquenots) est dominée par Fruzsina Hais, qui joue Anna, une orpheline de dix ans d’une aide précieuse pour le héros Tomàs. Charismatique et jolie comme un cœur, la demoiselle vole la vedette et devrait logiquement refaire parler d’elle, sur les écrans de Hongrie et d’ailleurs.

MONA LISA AND THE BLOOD MOON
d’Ana Lily Amirpour
(États-Unis)
À côté des histoires mettant en vedette des enfants (c’est le cas du film précédent, ce sera encore vrai pour Les Innocents, Ogre et Egō), la compétition 2022 a fait la part belle aux femmes, devant comme derrière la caméra. Aussi les sélectionneurs ne pouvaient pas passer à côté de Mona Lisa and the Blood Moon, dernière réalisation d’Ana Lily Amirpour. Révélée en 2014 par son film de vampire en noir et blanc A Girl Walks Home Alone at Night, la cinéaste anglaise occupe une place singulière dans le paysage horrifique, celle d’une plasticienne arty un peu rock’n’roll (et qui fait aussi du skateboard). Il y a d’ailleurs beaucoup de musique dans Mona Lisa…, celle de Guglielmo Bottin, DJ et producteur italien dont plusieurs titres viennent secouer la bande son.
Le personnage-titre n’est pas la Joconde mais une jeune fille enfermée depuis dix ans dans un hôpital psychiatrique. Elle est dotée de pouvoirs surnaturels qui lui permettent de se faire la malle dans les toutes premières scènes. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps avant de s’évader ? Mystère, la question est légitime et pourtant elle restera sans réponse. Ana Lily Amirpour, animée d’un farouche esprit d’indépendance, n’entend pas se plier à tellement d’exigence narrative. Son poème visuel nous promène dans le Carré français de la Nouvelle Orléans le temps d’un vagabondage aux péripéties bruyantes et colorées. L’errance de « Mona Lisa » lui fait croiser le chemin d’une strip-teaseuse et de son fils. L’effeuilleuse est jouée par Kate Hudson, le gamin par un jeune acteur très expressif du nom d’Evan Whitten. Au triple-portrait de ces âmes aux parcours alternatifs vient s’ajouter celui, pas si dissemblable, d’un agent de police boiteux (il est blessé par l’héroïne évadée). Une expérience agréable de projection dans la mesure où, répétons-le, on est de nature à lâcher prise et se laisser happer par les ambiances. Info bonus bizarre : Amirpour est annoncée pour réaliser prochainement Cliffhanger, en ce moment en phase de préproduction et qui, comme son titre l’indique, n’est autre qu’un remake du film musclé éponyme (et plutôt pas mal) que Renny Harlin tourna il y a trente ans dans les Dolomites avec Stallone. Curieux de voir ce que l’avant-gardiste anglaise saura faire avec ça…

SAMHAIN
(YOU’RE NOT MY MOTHER)
de Kate Dolan
(Irlande)
C’est une évidence pour l’excellent public gérômois, l’épouvante est à même d’aborder à sa manière des questions sérieuses, comme le démontre ici Samhain de l’Irlandaise Kate Dolan. « Samhain » (prononcez sa-ouine), c’est le nom archaïque de la fête d’Halloween, qui marque la fin de la période estivale dans le calendrier gaélique, à mi-chemin entre l’équinoxe d’automne et le solstice d’hiver. La date approche lorsque l’histoire débute, et le ciel d’octobre grisâtre plombe les perspectives dans un quartier résidentiel déjà pas folichon du nord de Dublin. C’est dans ce lotissement que vit Char, une adolescente régulièrement malmenée par quelques-unes de ses condisciples sur le chemin du lycée. Angela, la mère de la jeune fille, est dépressive, elle a de plus en plus de mal à décoller la tête de l’oreiller et n’a plus d’élan même pour les tâches les plus élémentaires du quotidien. Un matin, la maman disparaît, laissant son véhicule portière ouverte sur le côté de la route. Elle reparaît quelques jours plus tard à la maison, indemne mais sa personnalité a changé. Passé le soulagement des retrouvailles, Char doit se rendre à l’évidence, elle ne reconnaît plus sa mère.

Le folklore celtique est riche de légendes et de personnages inquiétants, et c’est dans ce vivier que Kate Dolan a puisé pour déployer la dimension fantastique de son long métrage. D’un jour à l’autre, vous ne reconnaissez plus votre enfant ou l’un de vos proches ? Pas de doute, celui-ci a été victime d’un changelin, créature sortie du bois pour prendre son apparence et sa place au sein de votre famille. Traditionnellement, le changelin s’en prend au nouveau-né pour s’installer ni vu ni connu dans le berceau, mais ici c’est une adulte qui fait les frais des agissements maléfiques car la cinéaste se sert de l’argument surnaturel comme d’une métaphore de la maladie mentale et la dépression. D’où le titre original du film, You’re Not My Mother — tu n’es pas ma mère. Le constat terrible s’impose à Char, qui fait l’expérience d’une peur que jamais on ne voudrait éprouver, l’effroi de voir un être aimé changé par la maladie au point de devenir un étranger. Au soir du palmarès, Kate Dolan reçoit un Prix spécial du Jury mérité.

SHE WILL
de Charlotte Colbert
(Royaume-Uni)
Direction l’Écosse avec She Will, autre portrait de femme à porter au crédit de la sélection. Veronica Ghent (Alice Krige) a connu la gloire très jeune, adolescente, en jouant le premier rôle d’un film qui défraya la chronique à sa sortie. Mais à présent c’est une diva vieillissante, qui plus est diminuée : ayant subi une double mastectomie suite à un cancer, l’actrice convalescente accompagnée de son infirmière s’isole pour quelque temps dans une retraite hôtelière rustique perdue dans les Highlands. Elle le découvrira plus tard, les forêts environnantes furent autrefois le théâtre d’affreuses tortures et immolations de prétendues sorcières, comme il y en eut tant lorsque l’Europe pataugeait dans l’obscurantisme. Des martyres endurés par des innocentes, comme un lointain écho à d’autres tourments endurés par l’héroïne dans sa jeunesse, et dont on saura tout une fois l’histoire achevée.

La réalisatrice britannique Charlotte Colbert, dont c’est le premier long métrage, est une esthète qui aime la belle image. Contrairement à Samhain de Kate Dolan, au style très naturaliste, She Will joue avec les lumières, les formes, motifs et textures pour aboutir à un objet qui flatte l’œil. Voilà pour la forme. Dans le fond, le film est tout aussi séduisant avec un propos féministe parfois caricatural (les personnages masculins sont tous des salauds ou des pantins ridicules) mais empreint d’une vérité touchante dès lors qu’on a appris à connaître plus intimement le personnage principal, Veronica, au départ pathétique et hautaine. Une simple posture de défense qui évolue au fur et à mesure qu’infuse dans son corps et son esprit l’âme rebelle des « sorcières », dont les cendres nourrirent la matière noire de la tourbe. Du côté des femmes, magnifiques compositions d’Alice Krige (présente à Gérardmer et vue, entre autres, dans Silent Hill de Ch. Gans, dans Star Trek : premier contact ou encore chez Marvel avec Thor : le Monde des ténèbres) et de Kota Eberhardt, qui interprète Desi, l’infirmière particulière, personnage d’importance presque égale. Chez les hommes, aucun rôle flatteur, comme on l’a dit plus haut, ce qui n’a pas empêché le très cher (à nos cœurs cinéphiles) et illustre Malcolm McDowell de prendre part au tournage dans les habits d’un personnage secondaire et pourtant essentiel. Dans les salles françaises le 31 août.

THE SADNESS
(KU BEI)
de Rob Jabbaz
(Taïwan)
Après deux films « sérieux » et graves, le train de la compétition s’emballe en faisant un crochet par Taïwan. Une embardée qui fouette les sangs, on ne saurait mieux dire : un virus (tiens donc !) aux effets dévastateurs se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville et le pays. La peste psychotrope fait sauter toute inhibition chez les nombreux sujets contaminés qui, de simples citoyens, deviennent des bêtes sanguinaires s’adonnant au meurtre, à la torture et au viol. Sans parler des obscénités qu’ils crachent aux visages de leurs proies au moment de les supplicier. La ville se change en un maelström sanglant au milieu duquel Jim et Kat, un jeune couple, font ce qu’ils peuvent pour sauver leur peau…

Le maître d’œuvre de l’orgie (ce sont des hectolitres d’hémoglobine qui poissent l’écran) se nomme Rob Jabbaz, il n’est pas du tout asiatique mais canadien, quoiqu’il mène sa carrière à Taipei. Un port d’attache trop éloigné, peut-être, pour venir défendre son film à Gérardmer, et il aurait eu fort à faire car tout ce que le public compte de lecteurs de comics serait venu lui demander des comptes : nonobstant l’accumulation ludique d’outrances en tout genre (et il y a du jamais vu !) et la mise en scène chorégraphiée (on pourra passer et repasser la séquence hallucinante de la rame de métro repeinte en rouge, entre deux arrêts, du sol au plafond), Jabbaz se rend coupable d’une « adaptation officieuse » (périphrase diplomatique pour ne pas dire « plagiat ») de la bande dessinée américaine Crossed, au scénario et débordements identiques, et dont l’intégrale est sortie il y a deux ans chez HiComics (lire notre chronique). D’accord, il n’y a pas mort d’homme, si j’ose dire, et après tout F.W. Murnau lui-même n’hésita guère à s’affranchir des règles en adaptant en douce Dracula de Stoker sous le titre Nosferatu. Mais c’était quand même il y a un siècle et, depuis, les pratiques dans les mondes du cinéma et de l’édition ont bien changé…

ABUELA
(LA ABUELA)
de Paco Plaza
(Espagne/France)
Et on en revient à ce que nous disions plus haut : le cinéma fantastique est un moyen propice à aborder des sujets sensibles et sérieux, tout en offrant le plaisir d’une excursion sur les terres de la grande frousse. Dans son dernier film, Paco Plaza s’attaque à la question des personnes âgées dépendantes, ici la grand-mère — « la abuela » — de Susana, top-model espagnole qui fait sa carrière à Paris. Un coup de téléphone et tout change dans la vie de la jeune femme : victime d’un AVC, sa grand-mère Pilar (sa seule famille) doit bénéficier d’une assistance permanente à domicile. Très attachée à sa mamie, qui l’a élevée, Susana se refuse à la placer et revient s’installer en Espagne dans l’appartement de la vieille dame, le temps de trouver une solution qui convienne à toutes les deux…

Quand on n’est pas tombé de la dernière pluie et qu’on a vu plein d’autres films de trouille, on saisit parfaitement et rapidement où Paco Plaza et son scénariste, Carlos Wermut, veulent en venir. Et on n’est pas déçu. Il n’empêche que La Abuela « fonctionne » très bien, l’intérêt à suivre l’histoire ne faiblit jamais, grâce au duo d’interprètes (Almudena Amor, qui a vraiment été mannequin avant de devenir actrice, et Vera Valdez) et aux accents de vérité du script, qui dépeint non sans crudité l’épreuve que peut représenter, pour les proches, l’assistance aux personnes dépendantes. Paco Plaza soulève des dilemmes moraux liés de façon intrinsèque à la situation, tout en laissant sa place à l’intrigue fantastique, laquelle permet de faire d’une vieille dame, presque immobile, toute maigre et muette, un puissant vecteur d’effroi. Paco Plaza remporte le Prix spécial du Jury, ex-æquo avec le film de Kate Dolan. Entre la abuela madrilène et la mère de famille dépressive de Samhain, le Jury de la compétition des longs métrages (présidé par Julie Gayet) n’a pas eu le cœur de trancher. Sortie du film dans les salles françaises le 6 avril.

THE INNOCENTS
(DE USKYLDIGE)
d’Eskil Vogt
(Norvège/Suède/Danemark/Finlande/France)
Les dix films de la compétition (ainsi que les trente autres des sections parallèles — avant-premières et rétrospectives) ont été autant d’étapes dans des contrées géographiques et linguistiques très éloignées les unes des autres. « Les innocents » d’Eskil Vogt parlent norvégien, avec des dialogues joués en large partie par un groupe d’enfants. La petite Ida, huit ans, et sa famille emménagent pendant les vacances d’été dans un vaste quartier d’immeubles. Sur les terrains de jeux alentour, la fillette tombe sur Benjamin, guère plus âgé et solitaire. La bande s’agrandit avec l’arrivée d’Aïcha, élevée comme Ben par une mère célibataire, puis avec celle d’Anna, la grande sœur autiste d’Ida. Sous l’impulsion de Benjamin, les enfants se livrent à une série de jeux dangereux et macabres.

La blondeur de la petite Ida associée aux « jeux interdits » des enfants ne manque pas d’évoquer le souvenir de Brigitte Fossey, en 1952, devant la caméra de René Clément. Formé à Paris à la FEMIS, Eskil Vogt a sans doute vu le film en question. Cependant son style comme son propos sont très éloignés de ce titre patrimonial du cinéma français, et s’il fallait à tout prix pointer une filiation, c’est plutôt du côté de Stephen King qu’il faudrait chercher, car on n’oublie pas que le maître du fantastique littéraire américain est un des grands écrivains de l’enfance et de ses facettes obscures. Dans le petit monde bien à eux qu’ils se construisent, fermé aux regards et à l’entendement des adultes, les gamins s’avèrent dépositaires de pouvoirs, pour le meilleur comme pour le pire. Ben, notamment, souvent livré à lui-même, peu choyé par sa mère, se met à cultiver des dons de télékinésie et de manipulation mentale à même de faire de lui le maître maladroit et despotique de son propre univers.
The Innocents est visuellement splendide, et sa thématique riche et universelle passionnera certains autant qu’il en dérangera d’autres qui, péchant peut-être par candeur, auront du mal à admettre la peinture qui est faite des enfants et la violence de leurs agissements (le fait est que certains plans peuvent être perturbants — gare à la scène du chat !). Impossible en tout cas de nier l’audace du film et l’efficacité de son traitement jusqu’au-boutiste. Les petits comédiens sont frappants de vérité et le jeune Ben marque les esprits en s’octroyant haut la main une bonne place, au premier rang, sur la photo de classe des kids les plus crédibles et flippants du cinéma fantastique. Prix de la Critique et Prix du Public. À lire séance tenante, le texte de notre interview avec le réalisateur Eskil Vogt. Sortie du film dans les salles le 9 février.

OGRE
d’Arnaud Malherbe
(France)
Il fallait bien un film en français pour apporter une touche locale au Festival international, et c’est à Arnaud Malherbe (Grand Prix 2008 de la compétition des courts métrages avec son film Dans la peau) qu’est revenu l’honneur de représenter l’Hexagone. Et plus précisément le Morvan, puisque c’est là que le cinéaste a posé sa caméra pour tourner son premier long métrage. Chloé (Ana Girardot) et son fils de huit ans s’installent dans un village de la campagne bourguignonne. Un nouveau départ pour la jeune femme et le petit Jules (Giovanni Pucci), qui laissent derrière eux la vie urbaine et le souvenir traumatisant d’un conjoint et père violent. Mais le charme bucolique s’estompe vite lorsque l’enfant devine une présence hostile à l’affût dans ce nouvel environnement.

L’imaginaire enfantin est prompt à faire surgir tous les monstres, aidé qui plus est par une multitude d’indices venant suggérer au jeune héros dans sa bulle (il est sourd et coupe souvent son appareil auditif) qu’il n’est pas en sécurité. Arnaud Malherbe, qui a aussi co-écrit le scénario, tente et relève le pari d’une utilisation subtile du fantastique, qui autorise que les peurs et hantises du garçonnet se concrétisent à l’image. L’approche est intelligente, et l’équilibre bien trouvé entre l’imagerie horrifique traditionnelle et la densité psychologique du propos. Évidemment, ceux qui, appâtés entre autres par le titre, miseraient sur un film de terreur risquent d’en être pour leurs frais car Ogre n’est pas un « creature feature ». C’est en revanche le portrait sensible d’un Petit-Poucet qui aimerait s’engager confiant dans la vie en laissant derrière lui les chemins obscurs que lui a fait emprunter son enfance. On est avec toi, petit gars. Sortie dans les salles le 20 avril.

EGŌ
d’Hanna Bergholm
(Finlande)
Coup de théâtre, « twist », chute inattendue… C’est un peu ce type de surprise qui a cueilli les festivaliers au matin du dernier jour du festival. Alors que nombreux étaient ceux à prophétiser la victoire inéluctable au palmarès de The Innocents (film par ailleurs multirécompensé l’an dernier, par exemple à Paris, à L’Étrange Festival, et au Festival de Strasbourg), Egō est venu bouleverser les certitudes. Passé la présentation enthousiaste (et enthousiasmante) sur scène de la réalisatrice Hanna Bergholm, « super happy » de cette première mondiale sur grand écran à Gérardmer, on assiste à l’histoire d’une gymnaste de douze ans, poussée vers l’excellence par une mère narcissique et mégalomane. L’existence réglée au millimètre de la famille (complétée par un fils et un mari, réduits à l’état de figurants) sera cependant troublée — avant de sortir complètement de ses rails — par la découverte en forêt d’un œuf que Tinja, la jeune fille, va secrètement couver.

Habiles, le scénario et la mise en scène agencent une collection d’atouts qui permettent à Hanna Bergholm de se mettre dans la poche une bonne partie de la salle. Les visions surréalistes (tel l’œuf géant qui trône dans le lit) s’accordent avec l’extravagance de la mère de famille, la reine du show, dont les saillies d’un nombrilisme outrancier soulèvent plusieurs vagues d’indignation hilare. Sage et posée, résignée sous la coupe de sa mother (qui la rêve en championne des barres asymétriques pour pouvoir s’en vanter sur son blog), la petite Tinja n’en bouillonne pas moins intérieurement. Et c’est sa rage qui va sortir de l’œuf.
C’est vrai, le thème est un peu rebattu, et l’idée d’une créature venant incarner les colères et frustrations adolescentes n’est peut-être pas ce qu’on a vu de plus novateur cette année sur les écrans de Gérardmer. Mais la direction artistique impeccable et la force des portraits font s’écarquiller les yeux et battre les cœurs. En somme, le plein d’émotions, et c’est pile ce qu’attend le public du festival. Et les jurys : Egō remporte le Prix du Jury Jeunes (composé de neuf lycéens de la région Grand Est) et le Grand Prix décerné par le Jury des longs métrages. À lire sur Khimaira, notre interview avec la réalisatrice Hanna Bergholm. Sortie du film (en vidéo) le 27 avril.
Un très grand merci du rédacteur et de toute l’équipe de Khimaira à Sophie Gaulier, Florine Buttner et Anthony Humbertclaude (SG Organisation – Nancy), au Public Système Cinéma (Paris) et à tous les chaleureux bénévoles qui nous accueillent dans les salles (et même les vigiles qui nous passent au détecteur de métaux le font avec un mot gentil). Rendez-vous l’an prochain pour la 30ème édition !
Retrouvez nos comptes rendus des précédentes éditions du festival…
Et nos autres dossiers Cinéma :


Frissons au pensionnat (novembre 2020)

Proies & chasseurs (avril 2020)



Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)

Américains en vacances (septembre 2017)