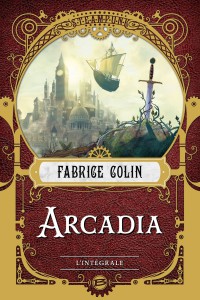L’ouvrage débute par un préambule, à la fois explication et avertissement : Arcadia, constitué de deux mouvements, Vestiges d’Arcadia et La Musique du sommeil, fut écrit à la fin du vingtième siècle en trois semaines à peine, « dans un état de transe ». Les conditions de rédaction furent singulières, d’où un objet littéraire « aux lignes narratives embrouillées », que Fabrice Colin aurait pu éventuellement reprendre à l’occasion de cette nouvelle édition, en format poche, à la belle couverture pourpre et or. Toutefois non : après réflexion, même si l’auteur, dans un premier temps, n’envisagea pas de laisser le texte en l’état, pas question de contrevenir à la « pulsion initiale » à l’origine de ce « texte magique ».
Arcadia s’affranchit de toute linéarité, c’est un long poème en prose, « tourbillonnant », dans lequel Fabrice Colin revisite — et réemploie, et ré-agence en démiurge — de larges pans de la mythologie anglo-saxonne. Suivant une démarche propre au courant steampunk, la fiction donne les premiers rôles à de nombreux personnages ayant existé (Dante Gabriel Rossetti, John Keats, Lord Alfred Tennyson, etc. — en fin de volume, huit pages de notices bibliographiques viennent raviver notre lanterne) et les confronte aux richesses de l’imaginaire britannique ou celtique : tout en relatant les destinées de deux mondes parallèles, Arcadia et Ternemonde, la plume de l’auteur fait apparaître dans une liberté totale des figures aussi diverses que la reine Victoria (ou plutôt Gloriana, son équivalent fictionnel), les héros du cycle arthurien, les Sidhe des légendes gaéliques, les victimes de Jack l’éventreur ou encore des animaux parlants tels qu’en croise Alice en plein Pays des Merveilles…
Arcadia, comme suggéré ci-dessus, raconte bien une histoire (les quelques lignes en quatrième de couverture veulent rassurer le lecteur à ce sujet). Un récit aux effluences enivrantes d’apocalypse, où les personnages, tous lieux et époques parallèles confondus, ont la conscience de plus en plus prégnante de l’imminence de la fin du monde. Une catastrophe qu’on peine un peu à apprécier à sa juste mesure (doit-on suivre le sens propre ? sommes-nous dans une métaphore ?), mais l’échéance inéluctable donne la matière à des tableaux saisissants, qui font honneur aux nombreuses références picturales du texte autant qu’ils fouettent l’imagination (telle, par exemple, l’exploration en scaphandre de la basilique Saint-Pierre de Rome engloutie sous les eaux — idée fantastique !). Sans fil rouge toujours bien visible pour le guider, le lecteur n’a cependant d’autre choix, pour ne pas lui-même se noyer, que de se raccrocher à la forme, une bouée d’une valeur inestimable : le style, d’une élégance sans faille, n’en finit jamais de charmer l’esprit, donc de maintenir l’intérêt. Certes, la multitude de trouvailles poétiques ne suffit pas toujours à nous épargner quelques flux et reflux de frustration due à nos attentes habituelles en termes de narration romanesque (curieux d’entrer dans le labyrinthe, on doit aussi avoir le courage d’y être perdu), mais elle suffit amplement à faire de la lecture une inoubliable expérience esthétique.
En librairie depuis le 12 septembre 2018.