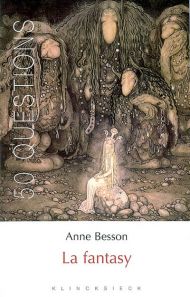Anne Besson est universitaire, maître de conférence en Littérature Générale et Comparée à l’Université d’Artois (Arras) et spécialiste de la fantasy sur laquelle elle a notamment écrit un essai très éclairant « La fantasy » (coll. 50 questions, Klincksieck). Elle est également co-fondatrice de l’association Modernités médiévales. Elle organise des cycles de conférences et journées d’études sur la Fantasy, c’est d’ailleurs peu après le colloque « La Fantasy en France aujourd’hui » tenu à Paris les 10 et 11 juin derniers qu’elle a accepté de répondre à nos questions.
Khimaira : Pourquoi parle-t-on de « modernités médiévales », de « médiévalisme », de « neomedieval » en littérature, musique, etc., aujourd’hui ? Qu’entend-on exactement par ces néologismes ?
Anne Besson : Pour parler de ce que je connais (la littérature plus que la musique, donc…) : « médiévalisme » et « néomédiéval » sont des traductions, et donc des tentatives pour importer en France des termes existant depuis longtemps aux Etats-Unis.
Le « medievalism » y désigne tout un champ de recherches universitaires, très développé là-bas (le rendez-vous annuel de Kalamazoo regroupe plusieurs milliers de communications !), car le travail sur les textes du Moyen Âge n’y est pas coupé de ses prolongements dans les siècles ultérieurs. « Modernités médiévales » est le nom de l’association que j’ai fondée en 2004 avec Vincent Ferré et Anne Larue (voir www.modernitesmedievales.org) pour contribuer à faire émerger en France ce type d’études – tout en évitant si possible les travers de la recherche américaine, très inégale… Notre idée consistait à introduire des travaux sur la fantasy dans un cadre disciplinaire qui lui donne une légitimité universitaire : en les rapprochant donc des autres exploitations littéraires du Moyen Âge depuis sa « redécouverte » par les romantiques français et les victoriens anglais.
« Néo-médiéval » s’utilise davantage pour désigner la fiction, afin de donner un équivalent français de l’abréviation « medfan », « medieval fantastic », qu’on ne peut pas reprendre tel quel parce que le « fantastique » américain correspond davantage à notre « fantasy », c’est-à-dire, pour parler comme Todorov, au « merveilleux » plus qu’au « fantastique » (ce n’est pas simple !).
K : Vous expliquez que le Moyen-Âge a été choisi par la fantasy d’une part pour son bestiaire fantastique, son imaginaire mais aussi car il représente un « monde intact et préservé »…
C’est une explication également valable pour les festivals médiévaux ? Comment expliquer leur succès ?
A.B. : Le bestiaire merveilleux est malheureusement difficile à transposer dans la vie réelle ;-), mais les festivals, fêtes et autres banquets médiévaux, ou encore certains GN et certaines reconstitutions se rattachant à cette période, participent bien d’un goût similaire, et très répandu aujourd’hui, pour ce que semble offrir le Moyen Âge tel qu’on aime à se le représenter : au milieu de motivations très variables selon les activités (goût de l’histoire pour les reconstituteurs, dépense physique pour les adeptes du GN…), les participants semblent partager :
– un désir d’évasion (un monde alternatif qui propose de mettre le quotidien entre parenthèse),
– fortement ludique (on aime se mettre en scène, se déguiser, de plus en plus, rapprocher nos univers de jeux de notre quotidien : le médiéval n’en est qu’une variante, le gothique ou le cosplay manga en donnent d’autres),
– des « valeurs » associées quant à elles spécifiquement au Moyen Âge, qui vont de la proximité à la nature (rejoignant des intérêts écologistes aujourd’hui très partagés) à la convivialité – l’image de la « taverne », liée à la détente et à un contact facile avec d’autres gens partageant les mêmes envies. C’est un peu paradoxal, car le Moyen Âge était socialement très inégalitaire, mais cette période apparaît dans ces occasions de rencontres communautaires comme un « grand égalisateur » : les costumes ne sont pas tous aussi beaux, les contributions ne sont pas toutes aussi abouties, mais chacun peut participer pour peu de s’impliquer un minimum !
Pour plus de développements, via des articles universitaires accessibles consacrés à ces divers aspects, voir : l’article de Gil Bartholeyns et Daniel Bonvoisin sur les motivations des joueurs de GN et leur perception du Moyen Âge et les articles tirés du colloque « Le Moyen Âge en jeu » (université Bordeaux 3, 2008), sur les JdR, jeux vidéo, reconstitutions, médiations culturelles…
K : La fantasy semble avoir beaucoup de mal à se définir. Toute tentative se heurte à des contours flous ou part dans des directions diffuses aux multiples sous-genres. Évoquer tant de sous-genres, en voir surgir sans cesse de nouveaux, n’est-il pas une façon étrange de définir un genre ? On a l’impression qu’aussi bien les auteurs, les critiques ou les universitaires détournent la question de la définition du tout en s’arrêtant sur celles des parties, peut-être plus facilement circonscrites ?
A.B. : L’impossibilité de la définition est en réalité un problème partagé par absolument tous les genres littéraires : comment être assez large pour tout inclure, et assez précis pour ne pas « déborder » sur les domaines voisins ? La science-fiction en donne un exemple frappant : les études critiques à son sujet s’ouvrent traditionnellement sur une liste infinie des autres ouvrages ayant relevé le défi de la définition, et la question n’est absolument pas réglée ! On peut juger que la démarche est vaine en elle-même, car vouée à l’échec, ou bien, en voyant le bon côté des choses, se dire que ça laisse le champ libre pour d’autres tentatives dans le futur.
Pour la fantasy, une difficulté particulière vient de ce que les anglophones, auxquels nous reprenons le terme, ne désignent pas quand ils l’emploient la même chose que nous : « fantasy » y prend un sens plus large, englobant quasiment tous les genres de l’imaginaire, ce qui ne nous avance guère ! J’ai proposé pour ma part dans mon ouvrage, non pas comme une définition (car je savais à quoi m’attendre), davantage comme un ensemble de traits généralisés (qui seront amendés/contestés/complétés, c’est le but), « ensemble d’œuvres qui exaltent (ou parodient) une noblesse passée marquée par l’héroïsme, les splendeurs de la nature préservée et l’omniprésence du sacré, en ayant recours à un surnaturel magique qui s’appuie sur les mythes et le folklore ». On voit déjà que ça ne marche pas pour l’urban fantasy, pour laquelle il ne faudrait garder que la dernière partie de la phrase, au risque de retomber dans quelque chose de trop général !
J’en viens donc à la question des sous-genres et de leur multiplication : on touche ainsi à une autre difficulté de la définition des genres, qui est l’articulation de la théorie (qu’est-ce que ce genre ?) et de la pratique, en l’occurrence éditoriale (qu’est-ce qui est proposé aux lecteurs sous le label « fantasy » ?). C’est facile en effet de répondre à la 1ère question par la seconde : la fantasy, c’est ce qui se publie sous ce nom, mais, les impératifs commerciaux imposant un renouvellement constant, au moins minimal, de « l’offre » pour ne pas lasser la « demande », on aboutirait ainsi à ce que la définition du genre se modifie également en permanence, ce qui n’est guère satisfaisant… Là encore, pour ne pas être défaitiste, je précise qu’on n’a ce problème que parce que le genre est vivant et même en phase d’hyper-développement. S’il était figé, on serait certes plus à l’aise pour le saisir et le définir : mais il serait mort !
K : Autre flou, les origines de la fantasy. Doit-on remonter à tout récit imaginaire ou se limiter au moment où la fantasy est devenu un genre à part entière ?
A.B. : Pour moi, la réponse est claire : n°2, l’apparition du genre en tant que tel, la seconde moitié du 19ème siècle anglais (même si elle était annoncée en amont, rien ne naissant spontanément du jour au lendemain, de loin par exemple par le poème Paradise Lost de Milton, 1662 je crois, très influent sur les romantiques anglais, ou d’un point de vue réflexif, entre autres par l’essai de Samuel Coleridge, Imagination and Fancy, début 19ème). La fantasy, c’est le retour au merveilleux dans les siècles du désenchantement : cette distance avec ce qu’il essaie de ressusciter est pour moi constitutive du genre. Si l’on décide que les mythes étaient déjà de la fantasy, la question de la définition n’a plus (du tout) de sens…
K : Nombre d’oeuvres fantasy semblent s’inscrire dans une opposition entre la Nature/magie et la Raison. Est-ce là artifices d’auteurs ou une réelle volonté, inscrite dans l’ère du temps ?
A.B. : Eh bien, cela découle de ce que je viens d’écrire à la question précédente : la fantasy naît après l’avènement de l’esthétique classique (17ème), après l’âge des lumières et le triomphe de la rationalité philosophique et scientifique (18ème), après l’industrialisation (19ème : je vais vite), et naît d’un sentiment de rupture, qui est la conséquence « normale » de ces bouleversements longs, d’avec la nature et la magie qui lui étaient associées. Le rapport entre ces deux catégories, de la raison civilisée et son envers immémorial, constitue donc une des grandes polarités constitutives du genre, et il est normal que les auteurs se consacrent à l’explorer, en tentant de lui donner toujours de nouveaux contours – plus ou moins bien, car ils commencent à être nombreux sur ce créneau, et que du coup on a un peu l’impression qu’ils rabâchent. C’est aujourd’hui un cliché de dire que notre époque a besoin de sacré, de spiritualité, pour compenser un « sens de l’histoire » qui ne prenait pas franchement cette direction.
K : Le genre fantastique semble beaucoup souffrir de la fantasy. Nombre de ses figures ont été récupérées et transformées. On pense au vampire, au loup-garou. Que reste-t-il au fantastique qui n’ait été repris ou transformé par la fantasy ?
A.B. : Effectivement, l’émergence de la fantasy et son succès public ont entraîné une reconfiguration au sein des littératures de l’imaginaire : la science-fiction comme le fantastique souffrent violemment de cette concurrence et se trouvent peu ou prou absorbés par la fantasy. A cela, des raisons de politique éditoriale et de fonctionnement du marché du livre : les éditeurs et les libraires (puis les bibliothèques, les CDI…) doivent proposer aux lecteurs des œuvres identifiables comme conformes à leurs attentes, un « classement », et les auteurs sont bien obligés de s’adapter. Le fantastique avait cependant commencé sa « mutation » en amont, se renouvelant déjà largement sous la plume d’un Stephen King par exemple, et les œuvres « vampiriques », aujourd’hui si omniprésentes, me semblent relever encore de ce fantastique aux frontières élargies. En outre, des œuvres comme celles de Mélanie Fazi en France ou de Graham Joyce en Angleterre, continuent à illustrer le fantastique le plus « classique » qui soit, dans la lignée directe du genre français du 19ème s, des Maupassant ou Mérimée – l’intrusion d’un trouble, dont l’origine reste indécidable, au sein du quotidien familier qu’il vient remettre en question. Mais, nous en discutions encore récemment avec Mélanie Fazi, ces œuvres posent des difficultés de positionnement qui peuvent nuire à leur perception par le public, parce qu’il n’existe plus de « rayon », d’espace, pour le fantastique.
K : Le retard français explique-t-il son originalité ? En France, on a l’impression qu’on a d’abord voulu copier les maîtres anglophones pour ensuite, très rapidement, s’intéresser aux écarts, aux limites du genre?
Contrairement au monde anglophone qui affiche ses Tolkien, Lewis, Zimmer Bradley, Eddings, etc. Comment expliquez-vous l’absence d’oeuvres aussi fortes en France ?
A.B. : La tradition « historique » du genre est anglophone, et quand on a commencé à lire de la fantasy en France, tardivement (Le Seigneur des Anneaux n’est traduit qu’en 1973), c’est ce corpus-là qui a été progressivement mis à disposition : Tolkien mais aussi les américains ou les auteurs plus « pulp », Howard, Leiber, Moorcock… Les auteurs français, qui ont d’abord été des lecteurs (et aussi, bien souvent, des joueurs et/ou scénaristes de JdR) se construisent eux aussi par rapport à ces modèles – ils n’ont pas d’équivalents en France, parce qu’historiquement la littérature merveilleuse y est faiblement représentée (pour des raisons culturelles anciennes : nous serions plus « cartésiens ») : elle a glissé très tôt vers le public jeunesse, ou bien s’est perdue dans le réalisme dominant (Salambô de Flaubert, La Peau de Chagrin de Balzac…)
L’autre grande différence entre les deux aires culturelles qui explique les spécificités de la fantasy française, c’est la conception du métier d’écrivain : pour le dire vite et de façon un peu caricaturale, en Angleterre et aux Etats-Unis (en Allemagne aussi, culture protestante oblige), l’écrivain est un artisan, un « professionnel » qui a intégré les contraintes du marché, tandis qu’en France, l’écrivain est un artiste, dont l’œuvre est l’occasion d’exprimer une singularité personnelle, et qui va dès lors viser l’originalité. Tendanciellement toujours, les premiers auront plus de facilité à respecter des codes de genre, les seconds tendront spontanément à s’en éloigner, et c’est un fait que chez les écrivains français aujourd’hui on ne trouve pas ce qui plaît pourtant le plus au public, de la bonne vieille quête épique ! Les quelques exemples qu’on a pu en avoir aux débuts de la fantasy française (les premiers Fabrice Colin, Loevenbruck, Grimbert…) s’expliquent en bonne partie par le contexte éditorial : celui du « premier Mnémos », alors dirigé par Stéphane Marsan et issu de Multisim, des éditeurs de jeux de rôles, qui cherchaient à publier un type spécifique de fantasy et encouragaient les écrivains dans ce sens. Les auteurs français d’aujourd’hui privilégient en effet l’exploration des marges du genre, la recherche d’un style personnel et d’un imaginaire original, ou bien le jeu sur les codes et les croisements de genre, avec un goût marqué pour le roman historique (Pevel, Mauméjean). C’est moins le cas en littérature de jeunesse, où il apparaît peut-être plus naturel de respecter certaines contraintes, et les gros succès en terme de ventes des auteurs français sont en conséquence à chercher plutôt de ce côté-là…
K : Si l’on regarde du côté des succès publics, deux oeuvres semblent incontournables aujourd’hui: Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Si, comme vous l’écrivez, le Seigneur des Anneaux est une réponse de Tolkien à son refus de modernité technologique, que représente Harry Potter ?
A.B. : Une problématique très contemporaine, qui parle aux enfants (et aux adultes « adulescents ») la difficulté et la nécessité de grandir – soit une sorte de réponse au si répandu « syndrôme de Peter Pan » dans notre société. Je tire cette idée, que je partage, de l’ouvrage d’Isabelle Cani sur les 7 volumes, Harry Potter ou l’anti Peter Pan, Fayard, 2007. Mais des œuvres telles que celles-ci ne se réduisent pas à un seul message bien sûr… On peut ainsi, par exemple, souligner que le SdA et HP partagent, à plusieurs décennies d’écart pour leurs rédactions, une réflexion sur les leçons à tirer de la Seconde Guerre Mondiale : le pouvoir comme tentation du mal, la nécessaire tolérance, le bon usage du libre-arbitre contre les aveuglements collectifs….
K : Vous expliquez que le succès de la fantasy tient finalement beaucoup à deux phénomènes: la tradition du pulp américain et le jeu de rôle. Croyez-vous que sans ces deux phénomènes, la fantasy n’aurait pas eu le succès qu’on lui connaît aujourd’hui ? Ou n’en sont-ils que des accélérateurs ?
On voit également, dans les accélérateurs du genre côté public, le fort impact du cinéma. Un impact qui va également de pair avec des phénomènes sociétaux. Conan dans les années 80 (années du culte du corps) et Le Seigneur des Anneaux dans les années 2000 fortement marquées par un retour de la magie et des croyances…
A.B. : C’est difficile de refaire l’histoire et d’imaginer « ce qui se serait passé si… ». Mais si l’on retire les pulps (qui sont antérieurs à Tolkien je le rappelle, et donc véritablement fondateurs) et le JdR, né dans la foulée du succès grand public de ce même Tolkien aux Etats-Unis, et contemporain des premiers romans qui souhaitent en prolonger l’héritage, qu’est-ce qui reste ? Tolkien seul, avec son œuvre érudite, et ses prédécesseurs anglais encore moins accessibles ? Pas sûr qu’on ait là la base d’un genre « populaire » (au sens noble) ! Pour cela, il fallait à l’imaginaire merveilleux et mythique des relais sur des supports plus facilement reçus par tous : les magazines bon marché mais aussi, le texte n’étant pas, ce n’est pas une découverte, la forme culturelle la mieux partagée, les bandes dessinées, le jeu, le cinéma bien sûr – même s’il y a peu de « chefs-d’œuvre » de fantasy au cinéma, où la science-fiction par exemple a été nettement mieux traitée.
Bien sûr, les succès des adaptations de « Conan » et du SdA sont liés à leur contexte d’époque, mais ça me semble une question de bon sens, voire une lapalissade : les producteurs sont des commerçants, ils s’appuient sur ce qui marche autour d’eux pour estimer ce qui va marcher ; le body-building est à la mode, adaptons Conan ! « Harry Potter » marche fort, donnons (enfin) à Jackson le budget nécessaire !
K : Quel est le rapport entre la féerie et la fantasy ? La première est-elle plus qu’un simple catalogue où puiser des personnages pour nourrir la seconde ?
A.B. : Si par « « féerie » vous entendez la tradition du conte merveilleux, dont l’histoire littéraire remonte au 17ème siècle, elle constitue une des principales sources d’inspiration de la fantasy, avec les mythologies (certains estiment même que les contes font partie d’une fantasy qu’ils font remonter très loin dans l’histoire, mais ça n’est pas mon cas). La fairy-tale fantasy s’en nourrit directement, mais son influence diffuse est plus largement présente : on prendrait alors « féerie » dans le sens de « merveilleux lumineux », du côté d’un surnaturel positif, des beautés de la nature, des créatures bénéfiques, de la magie blanche.. Enfin, sous le nom de « Faërie », Tolkien a décrit sa propre démarche, qu’on appelerait aujourd’hui « fantasy », dans son bel essai « Du conte de fées ».
K : Dans votre livre, vous évoquez le fait que les auteurs n’ont pas une connaissance directe des sources, qu’ils s’inspirent plutôt les uns des autres. N’y a-t-il pas un danger de voir s’effacer ces sources, que les contes, légendes, mythes, l’Histoire se dénaturent par la fiction ?
A.B. : Je ne crois pas, pas vraiment. Certes, certaines œuvres aboutissent à des « gloubiboulga » terribles, et dès lors qu’une erreur est reprise, il devient difficile de la distinguer de la vérité – le même phénomène se produit à plus grande échelle sur Internet… Mais d’une part, on est ici dans la fiction, et je fais confiance au public pour pouvoir en prendre conscience ; et dès l’origine de la transmission des fictions, que ce soient les mythes, la légende arthurienne, les épopées orales, le processus de déformation était à l’œuvre. Il faut de très longues années d’études et une spécialisation très érudite pour s’y retrouver dans ces sources anciennes et reconstituer la « vraie » version, si tant est qu’elle existe ! Tolkien, toujours dans « Du conte de fées », évoquait déjà (dans les années 30) le « chaudron du conte », une « soupe » où chaque époque a ajouté ses ingrédients, en touillant bien l’ensemble pour qu’il reste « mangeable » !
D’autre part, dans « culture populaire » il y a « culture », et pour moi le succès de la fantasy aujourd’hui se traduit par une connaissance partagée plutôt impressionnante, dans un public très large, des différentes mythologies par exemple. Je le constate auprès de mes étudiants : ce type de lectures les incite en fait à effectuer un « retour aux sources », ils cherchent à déterminer ce qui est nouveau de ce qui vient de plus loin, ils se renseignent… et au final ils emmagasinent un bon bagage de connaissances, avec les nuances que j’ai dites plus haut – c’est une connaissance des origines du merveilleux telle qu’elle est accessible aujourd’hui, passée par le filtre déformant des siècles, mais cela n’en reste pas moins une forme d’érudition contemporaine, valide et valable.
K : Vous décrivez la fantasy comme multimédiatique, transposable dans une multitude de médias, ce qui en explique aussi le succès. La science-fiction ou le fantastique n’ont-ils pas le même potentiel ? Pourquoi la fantasy serait-elle plus multimédiatique que d’autres genres ?
A.B. : Il y a effectivement des traits communs aux « genres de l’imaginaire » qui favorisent leur transposition sur les supports médiatiques les plus divers : d’une part le public qu’ils touchent préférentiellement (les « jeunes », aux contours de plus en plus larges), plutôt férus d’images et de technologies, suffisamment « fans » pour consommer des produits dérivés, et du côté des contenus la liberté dont ils disposent (l’intervention du surnaturel anime bien les combats, par exemple…). La SF et la fantasy (le fantastique à la rigueur, si on le considère dans son sens élargi) disposent aussi de chronologies et de géographies potentiellement infinies, où déployer des cycles ou des univers partagés. La fantasy m’apparaît toutefois encore plus porteuse, pour deux raisons principalement : par raport au fantastique, elle propose des univers plus « profonds », ou plus complets (voir sa vieille habitude de proposer des cartes, des chronologies, des lexiques : le monde et les récits qui s’y déploient se mettent en place simultanément) ; par rapport à la science-fiction, elle est plus simple, plus « spontanée » : pas besoin d’être technophile ou doté d’un esprit « scientifique » pour l’apprécier, sans compter son évident caractère pratique pour les créateurs (ses décors en partie naturels par exemple, ou encore la répartition facile de ses personnages en « types » ou « classes »). Il faudrait bien sûr préciser selon les médias concernés…
K : La fantasy est encore marquée par un temps cyclique, le refus d’une fin… Une façon de répondre à l’angoisse de la mort ?
A.B. : Le principe du temps cyclique n’est pas tant de refuser la mort que de n’y voir qu’une étape elle-même transitoire : dans le cycle des saisons, il faut en passer par le froid et l’obscurité de l’hiver pour, à Noël ou au solstice, mieux se réjouir de voir bientôt renaître la nature. Je ne veux pas dire par là que la fantasy véhicule une croyance dans la réincarnation ! Pour moi, elle correspond au niveau de chaque individu à un désir de préserver une forme de contact avec l’enfance, ou du moins avec l’image qu’on se fait de l’enfance aujourd’hui. La fantasy n’empêche pas de grandir, elle n’est pas régressive à mon avis, mais elle donne sens à un regret qu’on a tous, la nostalgie d’une époque plus « merveilleuse » dans la vie de chacun. Si l’on élargit, de l’individu-lecteur aux grandes tendances de l’époque, l’émergence de la fantasy correspond globalement au moment des grandes antiennes sur la « fin », fin des idéologies, des croyances collectives, fin de l’Histoire… Du côté de l’évasion et du divertissement, « modestement » donc, la fantasy peut apparaître comme une forme de réponse à ces constats désespérants, car son temps et ses histoires se donnent justement comme infinis.
K : Finalement, la fantasy est-elle un genre à message ?
A.B. : Il y a une part de permanence du genre à travers les décennies (il n’est pas encore très vieux…), mais pas de message unique commun me semble-t-il. Et puis, une part de renouvellement, heureusement, qui bien sûr coïncide avec l’évolution des intérêts de chaque époque : le genre entre autres s’est fait de plus en plus porteur de messages de tolérance, ou encore il a vu l’éclosion de nombreuses œuvres féminines ou féministes qui sont venues équilibrer un côté un peu machiste à l’origine. Que les littératures de l’imaginaire, même si elles s’affichent comme « non-mimétiques », ne soient pas déconnectées des réalités de l’époque où elles sont produites me semble évident, mais en même temps ce n’est pas forcément ce qui m’intéresse le plus en elles. Les lit-on vraiment pour le « message » qu’elles véhiculent, trop souvent convenu, ou plutôt pour le plaisir d’immersion dans un autre monde qu’elles nous procurent ? Ce serait peut-être ça, alors, le message partagé : d’autres mondes sont possibles…
Propos recueillis en juin 2009.